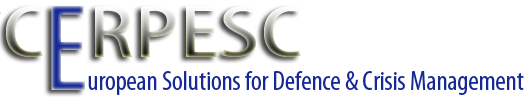You are here
Feed aggregator
Le budget de l’agence augmenté
La mobilité militaire devient un sujet communautaire. Un autre tabou est levé
La PESCO, le nouveau projet européen de défense va voir le jour
Les Européens se saisissent du manche… Ils déclenchent le projet de Coopération structurée permanente (crédit : Marine FR / DICOD / EMA)
(B2) Plus d’une vingtaine d’États membres, par l’intermédiaire de leurs ministres des Affaires étrangères et/ou de la Défense, doivent apposer, lundi (13 novembre), leur signature sur un document. La première pierre à une nouvelle coopération au sein de l’Union européenne, la « coopération structurée permanente » en matière de défense.
La date est symbolique : tout juste deux ans après les attentats de Paris (Bataclan, terrasses, Saint-Denis) qui ont entraîné le déclenchement (pour la première fois de la courte histoire européenne) de la clause d’assistance mutuelle (article 42.7). Mais il ne s’agit pas en soi du « vrai » lancement : celui-ci devrait avoir lieu à la mi-décembre, lors d’un autre Conseil de l’UE.
A la pêche aux bonnes volontés
Cette coopération est plus connue sous son acronyme anglais « PESCO » qui a l’avantage de la simplicité. Un mot qui signifie aussi « je pêche » en espagnol. Ce qui n’est pas tout à fait éloigné en fait du processus engagé. Les Européens lancent le filet… Et on verra bien ce qu’on récoltera. Certains savent qu’ils veulent récolter du poisson, d’autres ont juste pour envie d’être à bord du bateau de pêche, d’autres sont les armateurs.
Combien de pays exactement participeront ?
Une vingtaine tout de suite (le chiffre exact sera connu d’ici la fin de journée) et sans doute 24 ou 25 pays d’ici décembre. C’est-à-dire quasiment tout le monde sauf le Danemark (exclu par un opt-out datant du traité de Maastricht), le Royaume-Uni (pour cause de Brexit) et Malte (par manque de volonté). On est, en fait, assez loin, ainsi de la vision française (et de l’idée de départ des concepteurs de cette Coopération) : un noyau dur, organisé, structuré pour les opérations les plus ambitieuses possibles. On est plus proche, en fait, de l’idée allemande d’un rapprochement politique, progressif, à vitesses variables, avec des « nations cadres ». Mais, au final, l’important est de sortir ce « truc » de l’ornière où il avait été laissé depuis la fin des années 2000. Lire : La Coopération structurée permanente ou PESCO approuvée par 2X pays ? Explication
Que signifie cette coopération ?
Tous les mots ont leur importance. Ce n’est pas juste un projet de coopération « renforcée ». Il s’agit d’une coopération « structurée » et « permanente », à l’image de ce qui s’est fait pour la zone Euro et l’Union économique et monétaire. Une Eurozone de la Défense en quelque sorte.
A quoi s’engagent les signataires ?
Les Etats membres qui participent ne s’engagent pas en soi à dépenser davantage pour la défense mais surtout à dépenser mieux et en évitant les duplications. Ils vont s’engager ainsi à consacrer un peu plus d’argent de leur budget défense aux équipements (20% au minimum de leur budget défense) et au développement technologique (2% au minimum de leur budget défense). Ils vont s’engager, aussi et surtout, à travailler davantage en coopération, sur différents projets industriels, capacitaires ou opérationnels. Ils s’engageront enfin à fournir hommes et équipements pour les missions ou opérations décidées en commun, à améliorer la disponibilité de leurs forces, voire à accélérer leurs procédures internes de décision. Lire : Les vingt engagements de la PESCO dans le détail…
Comment va être contrôlé ce dispositif ?
On est dans un cadre politique essentiellement. Mais le dispositif n’est pas aussi lâche qu’on pourrait le penser. Chaque pays va être tenu de rédiger un plan de mise en œuvre, avant même le lancement officiel de la Coopération. Ce plan sera évalué par les services européens (état-major de l’Union pour l’aspect opérationnel et agence européenne de la défense pour l’aspect capacitaire) donnant lieu à une recommandation de la Haute représentante, et décision finale des États membres. Cette procédure sera ensuite répétée tous les ans, avec une évaluation commune.
Un Etat participant pourra-t-il être exclu ?
Pas exclu en soi … mais suspendu. Cette procédure est prévue expressément par le Traité. Si un État « n’est plus en mesure de remplir ces engagements, une procédure est prévue », comme l’explique un expert du dossier. « A la majorité qualifiée, les États participants peuvent décider après certaines étapes, que cet État ne participera plus ». Toutes proportions gardées, on n’est pas loin de ce qui se passe pour la Zone Euro.
Est-ce le début d’une force européenne ?
Non. Pas en soi. Mais cela ne l’interdit pas. Une série de projets vont voir le jour qui seront à connotation capacitaire, industrielle (le drone européen, la cyberdéfense, les ravitailleurs, les satellites) ou opérationnelle (un commandement médical, un hub logistique, une force d’entrée en premier, etc.)
Au final… un jour historique ou une simple étape
Certains qualifieront sans doute ce jour « historique » (1). Ce n’est pas le cas. Le dispositif de Coopération structurée permanente aurait dû être mis en œuvre dès la mise en place du Traité de Lisbonne, il y a presque dix ans (1er décembre 2009). Il s’agit donc plutôt d’une « étape », une étape nécessaire, primordiale, cruciale. L’Europe est en train de passer la première vitesse d’un dispositif appelé à grandir. Pour prendre une image plus maritime, le navire « Europe de la Défense » qui restait amarré dans le port, à l’abri des digues et des vagues fortes, détache les amarres pour aller voguer au large.
(Nicolas Gros-Verheyde)
(1) On a la qualification facile de l’histoire au niveau institutionnel européen, et ce terme est tellement galvaudé qu’il ne veut plus rien dire. Pour B2, il y a des jours historiques (la chute du mur de Berlin, ou l’accord de paix en Colombie). Celui-là n’en est assurément pas. Il s’agit plus d’une prise de conscience.
Lire sur le Blog :
- Une coopération structurée permanente plus politique que militaire ?
- La coopération structurée permanente à portée de main (août 2017)
- Les Européens brisent six tabous sur la défense (juin 2017)
- Un noyau dur devenu chamallow. Une coopération structurée permanente : pour quoi faire ?
Et sur B2 Pro (pour nos adhérents et abonnés)
- La Coopération structurée permanente ou PESCO approuvée par 2X pays ? Explication
- Les vingt engagements de la PESCO dans le détail…
- La gouvernance de la PESCO en détails
- PESCO : la Pologne traîne les pieds
- Coopération structurée permanente : six séquences à finaliser et imbriquer
- La coopération structurée permanente. Un cadre ou un processus ?
- Les 19 principes de la Coopération structurée permanente approuvés par au moins huit pays. Détails
Notre dossier :
Et notre suite chronologique
L’Institut d’études de la sécurité a une nouvelle équipe de direction
La Coopération structurée permanente ou PESCO approuvée par 2X pays ? Explication
Mogherini en mission à Washington pour convaincre. Le deal avec l’Iran fonctionne
Les vingt engagements de la PESCO dans le détail…
La gouvernance de la PESCO en détails
Carnet (9.11.2017). EUAM Ukraine (Odessa). EUBAM Rafah (Gaza, redéploiement). EUTM (plans de mission). EUNAVFOR Atalanta (adieux). Catalogue besoins 2017. Mobilité militaire (information). COPS (agenda). Non prolifération (budget). Resolute support ...
A l’agenda de la ministérielle Défense de l’OTAN (8 et 9 novembre)
PESCO : la Pologne traîne les pieds
Le Schengen militaire intéresse l’OTAN… et l’UE. Un plan d’action européen à l’étude
Deux conférences sur la Psdc dans les institutions européennes
(B2) Les questions de sécurité et de défense sont en haut de l’agenda politique des États Européens et le seront encore plus ces jours-ci avec la réunion du 13 novembre qui verra la Coopération structurée permanente, vieux projet datant à l’origine des années 2000, renaître de ces cendres. Tous les gouvernements en reconnaissent la nécessaire dimension européenne.
Tour à tour, Angela Merkel et Emmanuel Macron, Paolo Gentiloni, Bohuslav Sobotka ou Sauli Niinistö, etc. ont marqué leur adhésion et leur volonté de faire avancer ces projets. Les institutions communautaires, Jean-Claude Juncker d’un côté, Federica Mogherini de l’autre ont joué leur rôle, faisant différentes propositions, éventuellement de compromis, pour permettre à ces projets de voir le jour. Même au Royaume-Uni, le gouvernement de Theresa May a signalé l’intention du Royaume-Uni de continuer à coopérer après le Brexit avec les autres Européens.
Une conférence ce mercredi et ce jeudi
Dans le cadre des conférences de formation du regroupement syndical « Union pour l’Unité » (U4U), avec la revue Graspe du Groupe de Réflexion sur l’avenir du Service Public Européen et l’Association des françaises et français des institutions communautaires et européennes (AFFCE), je ferai un point sur toute l’actualité de la PSDC et de la défense européenne au sein des institutions européennes, ce mercredi 8 novembre, à 18h00, au bâtiment L-80 grande salle et jeudi 9 novembre 2017 à partir de 12h00 au SEAE. L’occasion pour ceux qui ne l’ont pas encore d’acquérir notre livre, rédigé avec André Dumoulin au tarif préférentiel.
Attention inscription préalable, ici (badge UE et inscription nécessaire pour entrer dans le bâtiment) : Information et inscription…
(Nicolas Gros-Verheyde)
Un général italien à la tête du comité militaire de l’UE à partir de 2018
La structure de commandement de l’Alliance revue et corrigée
5 morts au large de la Libye. Les garde-côtes libyens mis en accusation
Les sauveteurs du Sea-Watch 3 en action, en arrière plan le navire des garde-côtes libyens (crédit : sea-watch)
(B2) Le « comportement violent et imprudent des gardes-côtes libyens a causé au moins cinq morts en Méditerranée centrale » lundi (6 novembre) au matin, dénonce l’ONG allemande Sea-Watch.
Un incident survenu dans les eaux internationales
À environ 7 heures, l’équipage à bord de Sea-Watch 3 (qui venait d’arriver dans la zone) a reçu un appel du Centre italien de coordination des opérations de sauvetage maritime (MRCC) de Rome. Un canot pneumatique venait de lancer un appel de détresse. L’incident s’est produit à 30 miles nautiques, au large des côtes, au nord de Tripoli, « dans les eaux internationales, loin des eaux territoriales libyennes » raconte l’ONG. L’équipage de Sea-Watch 3 est « arrivé sur place à peu près en même temps qu’un patrouilleur de la Garde côtière libyenne et a commencé à embarquer des personnes en détresse ».
Une manoeuvre mortifère des garde-côtes libyens
La Garde côtière libyenne a « commencé à approcher le bateau et pris en charge des personnes à bord du bateau, les frappant et les menaçant. La panique à bord a commencé et de nombreux réfugiés sont tombés par-dessus bord ». Le bateau libyen a ensuite quitté les lieux, à grande vitesse. « Une vitesse inappropriée alors que les gens étaient toujours accrochés sur le côté, étant traînés par leur navire ». Au moins cinq personnes ont été tuées dans le naufrage du bateau, dont un enfant que l’équipe médicale à bord de Sea-Watch 3 n’a pas pu réanimer.
L’intervention d’un hélico de la marine italienne, un navire français non loin
Un hélicoptère de la marine italienne est alors intervenu, « arrêtant brièvement le navire libyen », permettant le sauvetage des autres personnes. Un autre navire « de la marine française » selon l’ONG était « présent » dans la zone. Mais les Libyens n’ont « pas cherché à se coordonner » avec lui. Au contraire, ils « ont tenté de ramener le plus de personnes possible en Libye, acceptant de perdre plusieurs vies » dénonce le chef de mission Johannes Bayer. 58 personnes ont cependant pu être récupérés par les militants de l’ONG. « Ils sont en sécurité à bord du Sea-Watch 3 ».
Une violation manifeste des règles de sauvetage en mer
Pour l’ONG, les gardes-côtes libyens ont « violé de façon manifeste le droit international en embarquant un nombre inconnu de personnes à bord de leur navire, probablement dans le but de les ramener en Libye ». « Nous étions en haute mer, en dehors des eaux territoriales libyennes, à environ 30 miles nautiques au nord de Tripoli. Là-bas, les Libyens n’ont aucun droit souverain », s’alarme Pia Klemp, capitaine du Sea-Watch 3. Sans leur action, tout le monde aurait pu être sauvé. « Personne n’aurait été obligé de mourir aujourd’hui si seulement nous avions la possibilité d’opérer raisonnablement dans un environnement calme » confirme Johannes Bayer.
Un appel à la responsabilité européenne
Ces morts n’ont qu’une cause, poursuit le responsable de Sea-Watch : « les gardes-côtes libyens qui ont entravé un sauvetage en toute sécurité par leur comportement brutal ». Mais la responsabilité « est aussi du côté de l’Union européenne qui forme et finance ces milices », souligne l’ONG. « Les gouvernements européens « doivent tirer des conclusions de cet incident et arrêter la collaboration avec les garde-côtes libyens ».
(Nicolas Gros-Verheyde)
NB : l’ONG allemande Sea-Watch a mis en cause régulièrement l’action des garde-côtes libyens
Pages